Le silence des parents aidants
Il y a des silences qui hurlent, des silences qui contiennent plus de mots qu’aucune phrase ne saurait porter, et des silences qui s’installent dans la chair, dans le souffle, dans le regard. C’est dans ce silence-là que vivent beaucoup de parents aidants, ceux qu’on croise sans les voir, ceux qui apprennent à se taire pour tenir debout, pour ne pas froisser, pour ne pas effrayer. Ce sont les parents qui connaissent trop bien le bruit du monde, mais n’ont plus la force d’y répondre.
Les silences assourdissants
Le monde parle fort, très fort, trop fort. Il donne son avis, juge, conseille, compare. Il a toujours une solution, un exemple, un “moi, à ta place, je ferais autrement”. Mais face à la complexité du quotidien d’un enfant qui demande tant, le langage du monde devient vite inutile. Très souvent, le parent aidant se tait. Il écoute, il acquiesce, il hoche la tête. Mais dans sa tête, le tumulte continue : les rendez-vous à enchaîner, les dossiers à remplir, les nuits hachées, les crises imprévisibles, les inquiétudes pour l’avenir. On croit qu’il ne dit rien, mais en réalité, il parle sans cesse — intérieurement. Il parle à l’infirmière qui ne comprend pas, à l’enseignant qui minimise, à l’entourage qui détourne le regard. Il parle dans le vide, faute d’oreilles capables de vraiment entendre. Mais tous les silences ne se valent pas.

Il y a d’abord le silence choisi, celui qu’on adopte volontairement par fatigue, lucidité ou simple instinct de survie. Parce qu’on comprend vite que crier sa colère ne sert à rien, qu’expliquer encore et encore, c’est s’épuiser pour rien. La diplomatie finit par devenir une habitude, presque un réflexe de protection, alors, on apprend à se taire et à sourire poliment quand on nous parle “d’inclusion” en détournant le regard. On apprend à dire “ça va” même quand tout brûle, à accepter sans répondre quand on nous dit qu’on dramatise, qu’on se plaint trop, qu’il faut “relativiser”. On se tait pour ne pas être étiqueté : parent agressif/fusionnel/dans le déni/dans l’excès où que sais-je d’autre. On se tait parce qu’on a besoin de ces structures, de ces soins, de ces accompagnements, et qu’il faut ménager les susceptibilités pour que la porte reste ouverte. On se tait parce qu’on ne veut pas être celui qui dérange, et que se taire est un bon compromis entre dignité et nécessité. C’est le prix à payer pour exister dans un système qui ne laisse aucune place à la différence.
Ensuite, il y a le silence imposé, que l’on subit, qu’on nous impose parce que notre réalité dérange. Quand on parle, on nous dit que c’est trop. Quand on raconte, on nous répond que “tout le monde a des difficultés c’est pas pour autant qu’on en fait tout un drame”. Quand on demande de l’aide, on nous dit qu’il faut patienter, remplir un autre dossier, attendre une commission, que c’est plus dur pour d’autres, qu’il y a des cas « plus importants ». Alors on finit par ne plus rien dire du tout. Les mots s’usent et avec eux les forces. On devient invisible, parce que notre histoire n’entre parfaitement dans aucune case, et que nos émotions débordent de ce que la société juge acceptable.
Et finalement, il y a le silence fait de lassitude. Ce silence là est rempli de phrases inachevées, de soupirs étouffés après un énième appel inutile. C’est le silence qu’on a face aux institutions censées nous écouter, nous soutenir. On y dépose nos vies entières sous forme de formulaires, de dossiers épais de preuves, de bilans, de certificats circonstanciés . Chaque mot y est pesé, chaque phrase relue plusieurs fois, parce qu’on sait que la moindre omission, la moindre nuance mal comprise peut faire basculer une décision. On espère une reconnaissance, une main tendue, mais trop souvent, on reçoit juste un courrier type glacial mentionnant un refus suite à un simple verdict administratif impersonnel. Alors on se tait. Pas parce qu’on accepte, mais parce qu’on n’a plus la force de se battre contre un mur, que les recours prennent des mois, parfois des années, et qu’entre-temps, la vie continue — avec les soins, les angoisses, les nuits blanches, et qu’on préfère garder de l’énergie pour cela. Ce silence est subtil, mais terrible. C’est celui des soirs où tout le monde dort enfin, et où le vide fait un peu peur, celui des larmes qu’on retient, parce qu’on n’a plus l’énergie d’expliquer pourquoi, celui du désarroi qu’on cache derrière un ton doux, pour ne pas inquiéter.

C’est aussi un silence d’impuissance, un silence amer qui dit « je n’en peux plus de devoir prouver que mon quotidien est lourd, que mon enfant souffre, que je ne mens pas, je n’invente rien». Il se dresse là où il devrait y avoir de l’écoute et transforme les parents en demandeurs, les enfants en dossiers, les détresses en statistiques. Et pendant que les enveloppes administratives s’empilent, les jours passent — lourds, sans répit pour les parents qui parlent de survie quand on leur parle d’inclusion. Mais ils se taisent pour protéger leur enfant — et parfois, pour se protéger d’eux-même.
Entre deux mondes
Le parent aidant vit souvent dans un décalage intérieur : il doit être fort quand il se sent fragile, calme quand tout s’effondre, lucide quand il voudrait juste pleurer. Il vit constamment entre deux réalités : celle de son enfant, qu’il comprend profondément, et celle du monde, qui lui échappe. Il parle pour deux, il pense pour deux, il s’oublie sans s’en rendre compte. Il traduit sans cesse : les émotions, les comportements, les besoins. Il devient interprète, médiateur, bouclier et perd peu à peu sa propre voix.
Le parent aidant sait écouter autrement. Il entend les nuances, les respirations, les besoins muets. Il comprend sans qu’on lui dise, devine sans qu’on explique. Son silence n’est pas vide. Il est plein d’amour, d’observation, d’attente. C’est un silence de veille. Celui qui précède un geste tendre, une main posée, un mot rassurant. C’est dans ce silence que naît la patience infinie, la résilience, la douceur obstinée. Mais à l’arrivée, il ne sait plus ce qu’il ressent vraiment. Il ne sait plus qui il est, en dehors du rôle d’aidant, il ne se rappelle plus quand il a eu, pour la dernière fois, une conversation légère. Il regarde les autres vivre, rire, planifier, et se demande ce que c’est, être simplement libre. On s’habitue à cela, comme à un vêtement trop serré et on s’y glisse chaque jour, en espérant que personne ne remarque la trace qu’il laisse sur la peau.
Le silence du parent aidant n’est pas un vide. C’est une prière, une veille. Ce n’est pas un choix romantique mais le résultat d’un monde qui ne sait pas quoi faire de la vulnérabilité. Il faudrait apprendre à entendre ces silences, arrêter de demander aux parents aidants d’être “forts” — comme si la force était une solution, et arrêter de les féliciter de leur courage pour mieux oublier de les soutenir. Car le soutien c’est ce qu’il leur manque le plus. Il faut qu’on leur laisse la possibilité de dire, de crier, de pleurer, de se reposer, sans avoir à se justifier.
Peut-être qu’un jour, ce silence sera entendu non comme une absence de mots, mais comme une présence immense. Il faut l’écouter. Pas pour conseiller, pas pour rassurer trop vite, mais pour entendre, vraiment.
Parce que derrière ce silence, il y a tout un monde contenu. Un monde d’amour inconditionnel, de luttes invisibles, de nuits blanches, de promesses tenues coûte que coûte. Un monde qui existe à l’ombre, mais qui fait tenir la lumière. Un monde qui dit, sans parler, tout ce qu’il y a de plus humain : aimer sans limite, et continuer malgré tout.
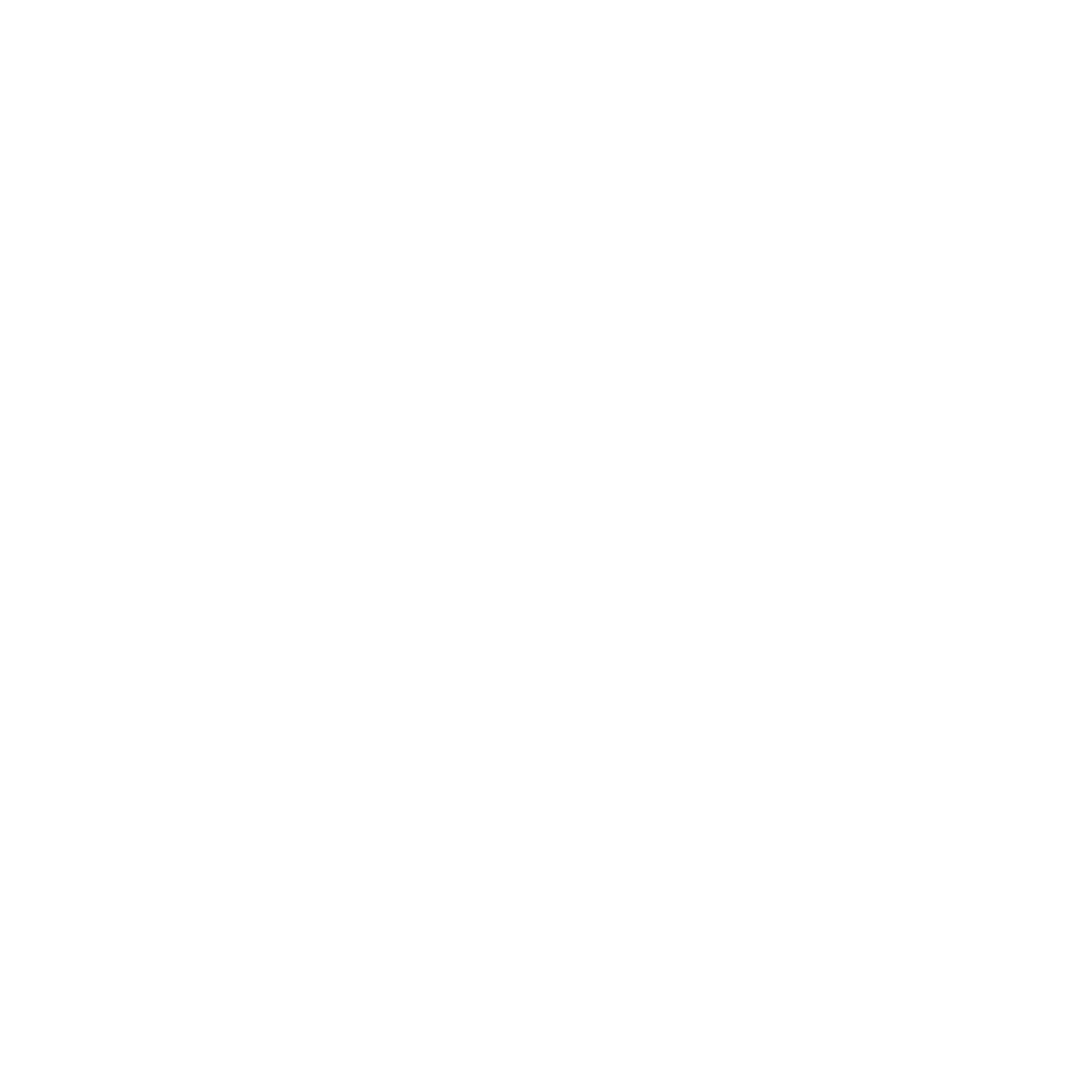
ca me touche tellement. Merci pour ce partage
J’aimeJ’aime